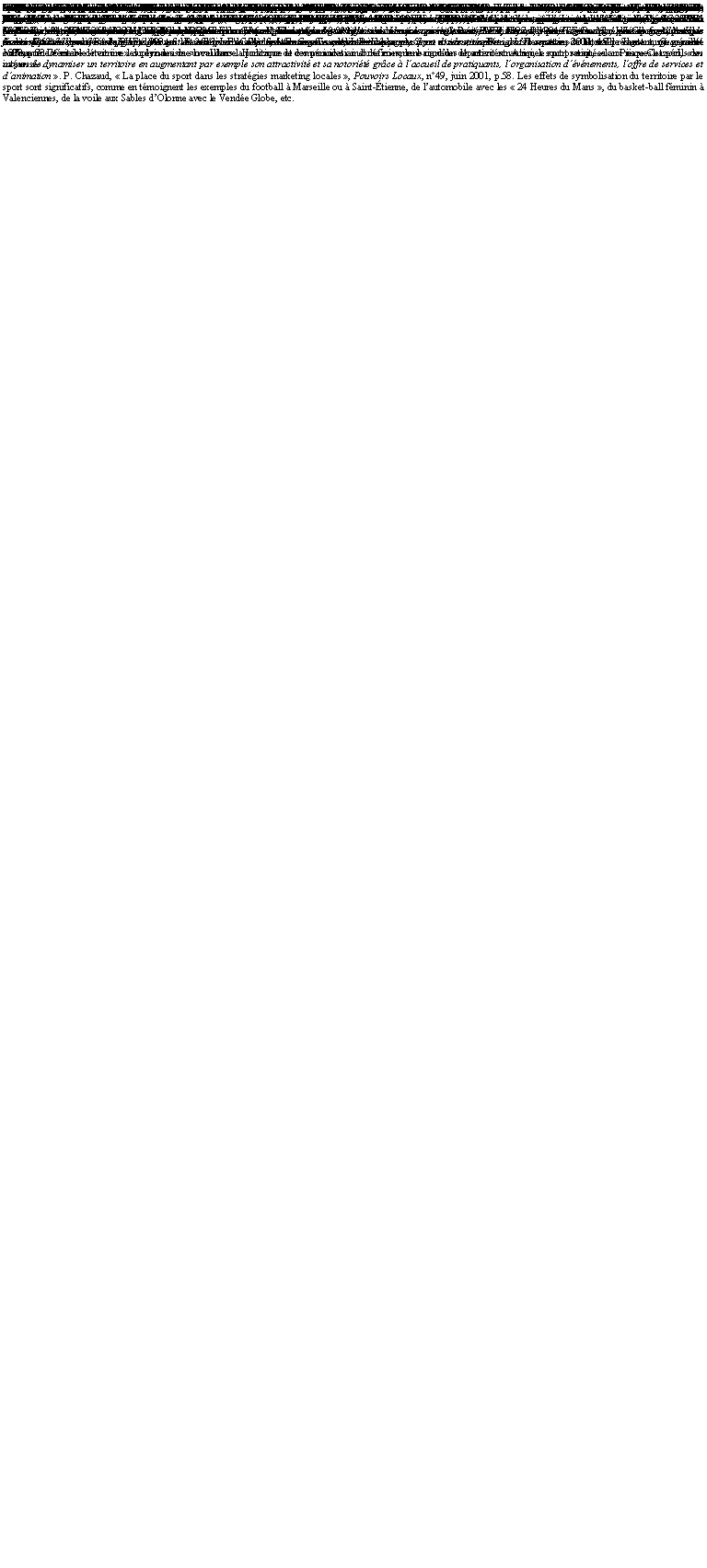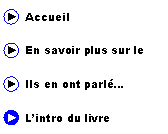
|
INTRODUCTION
Mardi 23 août 2005, journal télévisé de 13h de France 2. Un reportage expose « l’explosion du surf sur la côte aquitaine ». Rapidement, agrémenté de belles images de plages ensoleillées et de vacances, le propos se focalise sur des données socio-économiques : « 3500 emplois dans les entreprises du surfwear, un milliard d’euros de chiffre d’affaires. On ne compte plus les compétitions sponsorisées. […] Ce sport sur la Côte Basque surfe sur la vague sonnante et trébuchante ». L’interview de Pierre Agnès, le nouveau PDG de Quiksilver Europe pour qui « 90% des ventes, c’est les fringues et 10% c’est le technique », insiste également plus sur le « surf business » que sur la pratique elle-même. Ces quelques minutes dédiées au surf représentent le surf à l’aide des performances économiques « à deux chiffres » des entreprises du secteur puis à travers les compétitions des circuits professionnels de l’Association of Surfing Professionnals (l’ASP) où, en cumulé durant une semaine de compétition au mois d’août, plusieurs centaines de milliers de spectateurs selon les organisateurs encouragent les compétiteurs professionnels au bord de la plage. Mais pas le moindre mot sur les pratiquants, qu’ils soient des « locaux » ou des touristes. Pourtant, des pratiquants, en France, il y en a. Par dizaines de milliers, voire par centaines de milliers. C’est en 1956 que les premières vagues sont surfées en France. Concernant les plages d’une seule station balnéaire, Biarritz, sur lesquelles une vingtaine de surfeurs s’initie à la fin des années 1950, le nombre de pratiquants s’est nettement accru et les lieux de pratique se sont diversifiés sur tous les littoraux français. Récente sur le plan historique en comparaison avec les dates de création de la plupart des autres fédérations sportives, la Fédération française de surf, la FFS, a été créée en 1964 à Biarritz. L’approximation des données relatives au nombre de surfeurs témoigne cependant de la difficulté à objectiver avec précision la pratique hors du cadre fédéral. Pour les médias spécialisés, ce sont 100 000 pratiquants qui sont recensés sur l’ensemble des littoraux français. Dans les publications de la FFS, 60 000, parfois 100 000 surfeurs sont dénombrés. Enfin, Jean-Luc Arassus, le président de la FFS élu en 2005, estime que le nombre de surfeurs non licenciés en France est proche de 200 000 tout comme ce dirigeant d’association d’aide à l’insertion par le surf, « Surf Insertion ». Au-delà de ces estimations pour le moins hasardeuses, une des particularités de la pratique du surf est que le ratio pratique licenciée / pratique « libre » est très faible. Selon la FFS pour le compte de l’année 2004, 30 673 licences seulement ont été délivrées, tous types confondus – dont 5 000 environ de « pratiquants total », c’est-à-dire inscrits en club à l’année – ce qui positionne le surf comme un sport peu fédéralisé. Une des conséquences directes liées à ce constat est que la pratique de haut niveau est en France confidentielle, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Aucun surfeur professionnel français ne possède dans l’hexagone l’aura d’un Kelly Slater, le floridien sextuple champion du Monde de surf. Mikael Picon, le meilleur représentant français sur le tour professionnel indique en août 2005, dans une page du Monde qui lui est consacrée : « ‘’Mes objectifs étaient atteints en Europe, et il fallait que je passe dans le circuit mondial, qu'aucun Français n'avait jamais intégré. Pour progresser, il fallait que je sois avec les meilleurs, que je m'entraîne avec eux, même si c'était pour perdre.’’ Le jeune homme, qui a entre-temps choisi d'arrêter ses études pour se consacrer à sa passion, tombe de haut. Et apprend à encaisser les défaites : ‘’le niveau n'était pas le même, mais, surtout, ce qui était nouveau pour moi, c'était de rencontrer, sur toutes les compétitions et toutes les séries, des surfeurs différents, analyse-t-il. Sur le circuit européen, je connaissais à peu près tout le monde. Là, je croisais des gens dont je ne connaissais ni le nom ni la manière de surfer. J'étais habitué à gagner et j'ai souvent perdu. Tu prends des coups au mental. Il faut de l'expérience, pour ce circuit.’’ » Ces singularités où la Fédération fédère peu et où les champions français n’arrivent pas à tirer leur épingle du jeu à l’échelle internationale contribuent à définir des représentations à l’égard de la population des surfeurs. Les stéréotypes liés à une activité majoritairement pratiquée de manière « libre » ne manquent pas et uniformisent les surfeurs. Ainsi, pour cet auteur qui consacre un ouvrage à une petite station balnéaire landaise, « La population locale n’a pas vu arriver sans appréhension ces garçons dégingandés, stationnant près de la mer dans des minis-cars moins que sommairement aménagés, affranchis de toute discipline, peu respectueux de leur voisinage et tout entiers préoccupés de leur seule passion du surf. Leur présence a coïncidé avec l’apparition de la drogue dont toutes les stations balnéaires semblaient jusqu’ici préservées et celle de dealers venus chercher sur les plages une nouvelle clientèle. » Aussi, ce sport qui fait référence aussi bien à l’économie, à la compétition, à la « liberté », à l’écologie, à la déviance, etc. fait dire à Hugo Verlomme, un « éditeur-écrivain de surf » : « Soyons honnêtes : personne n’aurait cru, dans la France des années 1950, que deux générations plus tard, le surf serait devenu un sport passion, une mode déclinée à l’infini, un style de vie, de vêtements, un Eldorado financier qui bouleverserait des régions entières, bénies par les vagues. Toujours à l’avant-garde, le surf est même devenu le mot de passe de la révolution Internet, le voici qui explose dans la publicité, envahit la mode, devient une manne financière, une pompe à sponsors, mais aussi un sport de haut niveau, une philosophie, un art de vivre, un sujet d’inspiration pour les cinéastes, des photographes, les peintres et dessinateurs, les musiciens et les écrivains, une passion montante pour les nouvelles générations. » Telle qu’elle est utilisée ici, l’expression « le surf » uniformise en fait une réalité hétérogène et complexe. D'ailleurs, des journalistes voient dans cette activité « une pratique sportive amateur » ou « professionnelle », « un moyen de s’évader par le voyage », « un art plus qu’un sport » ; des élus locaux y voient « un simple jeu de plage », « un outil touristique », « des pratiquants socialement déviants » et/ou « un secteur vecteur de création d’emplois » ; des surfeurs y voient « une activité écologique », « un style de vie », « un rapport à l’océan », etc.
Au-delà du caractère polysémique du « surf » qui renvoie à de multiples significations parfois contradictoires, des sens et des représentations sont différentiellement appropriés et mobilisés par les équipes municipales du littoral aquitain. Prendre le surf comme objet de la production du territoire, c’est-à-dire comme effet de symbolisation, engage un éclairage original au sujet des politiques municipales en ce sens qu’il s’agit, pour une municipalité du littoral, de construire symboliquement du territoire, c’est-à-dire du « terrien », avec une activité « aquatique ». La pratique du surf ne suppose aucune infrastructure puisque « la vague », en tant qu’élément naturel, en est le support. Le lieu de pratique peut également changer en fonction des conditions climatiques. Les bancs de sable, qui contribuent à définir ce que doit être une vague de qualité, changent d’emplacement au gré des tempêtes et des grandes marées. Des vagues de qualité peuvent ainsi se situer sur les plages d’une commune puis se déplacer comme c’est souvent le cas dans les Landes sur les plages de la commune voisine. Autrement dit, le surf est une activité qui se pratique dans des conditions éphémères difficilement « maîtrisables ». Quoi qu’il en soit, la pratique estivale du surf s’impose, selon le législateur, à la compétence du maire en termes de police municipale. Délimitée dans certains lieux prévus à cet effet, la pratique du surf est interdite dans les zones de baignade, ce qui de fait en amoindrit le caractère « sauvage » et « libre ». La question qui inspire l’analyse peut en conséquence se poser en ces termes : en quoi les usages politiques de la malléabilité de l’univers multidimensionnel du surf et des « images » – ou des sens – qu’il génère contribuent-ils à définir des identifications territoriales différenciées ? Les usages politiques possibles de cet univers sont multiples pour un élu local en Aquitaine, a fortiori lorsque, sous l’étendard uniformisant du « surf » se dissimulent des réalités opposées : le surfeur « marginal », le surfeur « compétiteur », le « voyage » et la « liberté », l’économie et la rationalisation marchande, les références historiques variées, les compétitions professionnelles, etc. L’enjeu pour les maires et leurs équipes municipales, plus que le soutien à la pratique du surf elle-même, réside dans le développement de la commune à des fins de développement médiatique, économique, touristique, social et parfois sportif qui correspond le plus souvent à une logique de « marketing territorial » tel un produit d’appel. En effet, les analyses des stratégies d’identification menées par les maires et leurs équipes municipales questionnent, de fait, la place de la pratique et des surfeurs locaux dans les représentations des élus et dans les politiques municipales étudiées. Le substrat de l’instrumentalisation dans le travail de production du territoire est le surf et plus généralement l’univers du surf, c’est-à-dire la pratique mais aussi et surtout les grands événements médiatiques (festivals, compétitions professionnelles), les emplois directs ainsi que l’ensemble des représentations liées à cette activité. La production du territoire à l’aide de cet univers devient légitime aux yeux des élus, des médias et in fine des touristes et investisseurs lorsque l’identification communale qui en résulte est stable, originale et profitable politiquement. Cette différenciation des lieux est possible d’une part si l’identification territoriale, légitimée par les élus en direction de la population locale et des vacanciers est soutenue durablement et d’autre part s’ils sont réceptifs et croient aux retombées et profits éventuels. Il s’agit donc de saisir comment ces croyances différenciées sont produites et dans quelle mesure elles répondent à des mécanismes sociaux irréductibles à des choix individuels. Plus particulièrement, l’appartenance à un parti politique ou une « idéologie » politique n’est pas un critère opérant en soi. Les résultats du questionnaire passé par nos soins en 2002 à l’ensemble des maires des communes du littoral aquitain n’expliquent pas, à travers le prisme du clivage traditionnel « gauche-droite », les choix des municipalités en faveur ou en défaveur de l’univers du surf. Cet univers ne répond pas à un travail politique qui s’inscrit dans une logique partisane. Qu’il soit de gauche ou de droite, un élu peut tout aussi bien définir ses choix dans une logique de développement de l’emploi, de marquage territorial ou de politique « sociale ». Aussi, l’univers du surf s’apparente à un panel de ressources malléables et disponibles, parfois à l’envie, par les élus en fonction du contexte local en invoquant par exemple une période historique plutôt qu’une autre ou une modalité de pratique plutôt qu’une autre. C’est-à-dire qu’au regard des intérêts perçus, le surf est caractérisé de façon à faciliter la réalisation des profits escomptés. Il peut ainsi paraître étonnant de voir que certaines communes françaises sont qualifiées de « ville de surf » dans la presse spécialisée, alors que la qualité des vagues y est, pour ainsi dire, « moyenne » sur une « échelle de qualité » nationale. Plus que la pratique elle-même et le soutien aux surfeurs locaux, l’économie marchande et les manifestations médiatiques sont le moteur des actions municipales.
Mis à part le questionnaire adressé aux maires du littoral, la majeure partie du travail empirique, « sur le terrain », se compose d’entretiens auprès d’élus locaux (maires, adjoints chargés des affaires sportives, culturelles ou de la communication), mais aussi de dirigeants de fédérations et d’associations, d’individus exerçant leur activité professionnelle dans l’industrie du surf ou dans l’enseignement de la pratique, de responsables et moniteurs d’écoles de surf, de journalistes de la presse spécialisée, d’employés et directeurs d’office de tourisme, etc. L'usage des matériaux qualitatifs a permis d'avancer des explications en accordant une place importante aux dispositions et aux éléments discursifs sur les pratiques des agents sociaux. Au total, quarante-et-un entretiens ont été nécessaires à la mise à l’épreuve des hypothèses. Les ressources documentaires se révèlent également être d’une grande richesse. Les événements locaux, par exemple, sont largement retranscrits sur Internet et dans les « pages locales » de la presse régionale comme le quotidien Sud-Ouest ; ailleurs, les contenus et couvertures (photographies, titres) des magazines municipaux servent de vitrines aux collectivités locales dont ils sont issus ; enfin, les livres de surf et la presse spécialisée (Surf Session, Surf-Time, Trip Surf) représentent une mine d’informations difficilement « occultables », ne serait-ce que pour mieux les déconstruire et en saisir les effets sur les politiques municipales. Les diffusions successives qu’a connues le surf en France permettent de définir des identifications locales spécifiques aux caractéristiques spatiales et sociales. L’ambition d’analyser les singularités des politiques municipales des communes du littoral aquitain en direction du surf implique de choisir un terrain d’étude relativement étendu afin qu’il présente des caractéristiques historiques et socio-économiques variées. Concernant trois départements de la façade atlantique (Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques), le terrain privilégié de l’enquête se situe entre l’embouchure de la Gironde et la frontière espagnole, soit de Lacanau à Hendaye. Il englobe des espaces balnéaires « touristifiés » de façon plus ou moins tardive. Le recours à l’étude de cas s’est révélé une solution adaptée pour décrypter les mécanismes politiques et les enjeux liés au développement du surf. Les résultats obtenus, non exhaustifs mais néanmoins significatifs des possibilités d’actions politiques, s’observent pour des communes à des moments précis, ceux de l’investigation. Ainsi ont été retenues des communes réputées pour la pratique du surf (Biarritz, Anglet, Hossegor, Lacanau, etc.) puis des communes limitrophes, moins connues dans le monde du surf (Labenne, Seignosse, Bidart, etc.), afin de déterminer les logiques des politiques municipales en termes d’identification.
Aussi, cet ouvrage a pour ambition d’expliquer pourquoi le surf n’est pas inscrit de manière similaire sur les « agendas politiques » et envisagé selon les mêmes modalités par les équipes municipales. L’hégémonie régionale sur le plan institutionnel, des écrits universitaires puis des résultats issus de l’enquête quantitative portent pourtant à croire que le surf en Aquitaine est systématiquement présent dans les dynamiques d’identification territoriale des communes du littoral. Les caractéristiques historiques, sociodémographiques et également architecturales des villes prises pour objet contribuent au fait que le surf, eu égard à ses singularités spatio-temporelles et historiques, marquent différentiellement un territoire. L’univers du surf ne peut en effet être envisagé de la même manière par la municipalité d’une commune de 30 000 habitants de la Côte Basque, aux allures bourgeoises où le surf est pratiqué depuis une cinquantaine d’années, et par la municipalité d’une station de 3 000 habitants du sud des Landes, au tourisme familial plus récent et moins « réputée » pour la pratique du surf. Ainsi, l’articulation entre les propriétés des communes et l’espace du surf, bien que la pratique soit perçue comme une quasi exclusivité régionale, illustre le fait que des arguments de type symbolique soient parfois évoqués pour définir la politique municipale. Autrement dit, les propriétés communales, les caractéristiques locales du surf et le travail politique des élus municipaux s’emboîtent entre eux. La malléabilité du surf est utilisée en fonction des intérêts politiques au regard de chaque contexte local. Cet extrait du numéro 200 de la principale revue spécialisée française de surf, Surf Session, contribue à alimenter une vision composite du surf : « Outre d’être un sport, un mode de vie, le surf se vante d’être aussi une culture. Cela tient en premier lieu à ses origines ancestrales, mais aussi au fait que longtemps marginal, il resta original et indirectement influent sur l’état d’esprit de certaines époques. Ses accointances avec la musique, le voyage, la drogue, le retour à la nature, la liberté du plaisir à la fin des années 1960 en ont fait un élément dynamique de la contre-culture hippie et pop qui s’exprima alors. » La production de ce type de représentation est la conséquence d’un refoulement de références historiques où sont convoquées, notamment par les journalistes de surf, des constructions qui laissent une place importante aux mythes puis des représentations de l’activité qui sont très malléables. L’apparition tardive du surf en France puis sa relative confidentialité en termes de pratique renforcent cette malléabilité. Cette dernière confère du sens à l’analyse des politiques municipales quand elle est articulée avec les propriétés des communes prises pour objet. C’est ainsi par exemple que sont évoquées la « marginalité », la « désorganisation » et la « déviance sociale » des surfeurs pour légitimer des choix politiques dans des communes huppées des Landes pourtant aux allures de villes de surf reconnues dans la presse spécialisée. En conséquence de quoi une dissociation entre pratique et pratiquants est opérée par les municipalités concernées. Les choix politiques des maires et des équipes municipales se structurent en quelque sorte à partir de cette vision des choses qui constitue un prétexte à la politique menée. Ce dernier est mobilisé par certaines équipes municipales pour qui la pratique du surf et les surfeurs ne constituent pas une « ressource politique » probante – entendue ici comme un moyen instrumentalisé dont la mobilisation facilite la réalisation d’une stratégie politique. Ces catégories à disposition sont issues de représentations parfois contradictoires qui convergent pourtant vers une uniformisation des surfeurs qui est peu discutée. Si certaines municipalités du littoral aquitain désirent acquérir ou maintenir un rang élevé dans l’espace des villes de surf, c’est que les élus croient en la possibilité d’obtenir des profits économiques et touristiques pour leur commune. Mais puisque la pratique en elle-même ainsi que les surfeurs « ordinaires » ne sont pas prioritairement visés, eu égard aux représentations collectives jugées plutôt négativement par l’ensemble des maires, le jeu et les enjeux se situent ailleurs. Les constructions des journalistes et des discours marketing des entreprises du surfwear ne sont pas les seules à avoir des effets sur les catégories mentales des agents du champ politique. C’est en effet du côté des retombées économiques, médiatiques, touristiques et sociales qu’il faut chercher afin de saisir les actions des élus locaux pour qui être le maire d’une ville de surf est néanmoins profitable. Ces bénéfices peuvent être de l’ordre de l’intérêt général afin d’accroître le nombre de touristes et d’alimenter l’économie locale par exemple ou de l’intérêt personnel pour maintenir ou élever une surface sociale et politique, montrer que la municipalité et le maire agissent, etc. Les croyances différenciées des élus locaux qui se construisent en fonction des représentations collectives et personnelles puis du contexte local, sont constitutives des propriétés de leur commune et contribuent à définir des processus variés d’identification territoriale. Les manifestations et compétitions internationales qui s’apparentent plus à des politiques de communication que des politiques explicitement sportives, les emplacements géographiques des entreprises internationales du surfwear dont les demandes sont très largement prises en compte par les élus, ou encore la politique sociale des associations structurent pour partie l’espace des villes de surf du littoral aquitain. L’étude analytique des profits généraux escomptés et visibles ou personnels et cachés, ou en tous cas refoulés par les élus des communes du littoral aquitain, permet de prendre la pleine mesure de l’intérêt de l’identification communale au surf. Autrement dit, une commune peut devenir réputée pour la pratique du surf sans que l’équipe municipale en place, à quelques rares exceptions près, aide directement au développement de l’activité pour elle-même, ou, à l’extrême, sans que la qualité des vagues soit véritablement marquante. Plus l’enjeu s’éloigne de la pratique et des pratiquants « lambda », plus le dynamisme politique semble prépondérant. Ce sont les ressources territoriales locales (une compétition « ancienne » sur le circuit professionnel, une histoire singulière ou un regroupement d’entreprises multinationales) qui sont valorisées par les maires afin de marquer symboliquement leur commune. En effet, en aucun cas le dynamisme politique à l’égard des surfeurs « libres », c’est-à-dire des dizaines de milliers de surfeurs en période estivale sur les plages girondines, landaises et basques, se fait très prégnant. Bien que la production d’événements ou de manifestations transcende les frontières nationales et sociales (des étapes du Championnat du Monde professionnel ont lieu en France), elle se construit néanmoins par une réactivation forte des cultures régionales et locales comme en témoignent par exemple le « Lacanau Pro » ou le « Biarritz Surf Festival ». Malgré des volontés affirmées et affichées par certains élus de développer le surf de manière cohérente en termes de territorialité – entendue ici comme sens attribué par les élus à espace délimité de pouvoir politique légal –, au sein de structures intercommunales par exemple, il existe bel et bien de réels enjeux concurrentiels entre communes, et ce dans un souci de reconnaissance en tant que ville réputée pour le surf et municipalité active. « La vague » par exemple est perçue par certains élus comme une ressource naturelle rare, digne d’être conservée « entre ses mains » au risque d’engendrer des conséquences conflictuelles. Finalement, l’univers du surf se réduit pour les municipalités à un enjeu politique qui, malgré des aspects médiatiques très probants, n’encourage pas spontanément la croissance et la rationalisation de la pratique.
NOTA: les notes de bas de pages indiquant les références bibliographiques, les sources et autres informations ne sont pas présentes ici.
|